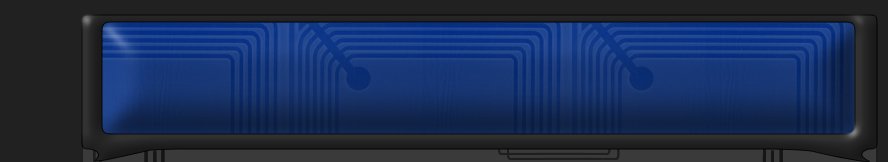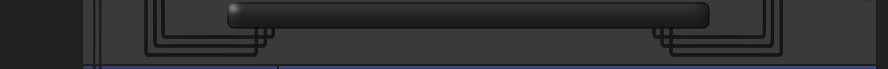|

TECHNOLOGIE
|
Une technologie de communication normalisée et performante est désormais disponible : LonWorks.Grâce à cette dernière, apparue en 1991, LonWorks est une technologie réseau étonnante à plus d'un titre.
|
|
|
Elle permet :
- Des communications sur tout type de support à des vitesses allant de 78 Kbps à 1,25 Mbps :
paire torsadée,
radio,
câblage d'alimentation (courant porteur)
Infrarouge
Fibre optique
….
- Le mixage des supports dans la même application.
En paire torsadée, le câblage du réseau peut être réalisé sans aucune contrainte :
bus,
anneau,
peigne,
étoile,
Tous ces supports sont non seulement possibles mais aussi combinables entre eux. De plus la paire n'est pas polarisée (la façon dont on câble la paire sur le bornier réseau de l'équipement n'a pas d'incidence sur le fonctionnement). Un des conducteurs de la paire peut être relié accidentellement à une phase du secteur (240V) sans danger pour l'équipement.
Des équipements peu gourmands en énergie peuvent même être alimentés par le réseau!
- D'adresser un équipement. Par fabrication chaque équipement a une adresse unique.
- De définir plus de 32000 équipements dans un " domaine " du réseau. Le nombre de domaines est quasiment illimité !
- D'échanger des informations normalisées sur le réseau : un capteur de température américain est directement exploitable par un régulateur italien car tous deux expriment une température de la même manière.
L'installation est de type " Plug & Play ". Lorsque l'on connecte un nouvel équipement au réseau, celui-ci est automatiquement reconnu par l'outil d'installation. Il ne reste plus qu'à établir les conversations qu'il doit mener avec d'autres équipements. |
Lonworks et LonTalk
| En dehors de son aspect multi-maître assez inhabituel, le protocole de communication LonTalk se distingue des protocoles généralement utilisés en GTB par une richesse fonctionnelle et une fiabilité exceptionnelles. Construit selon le désormais classique modèle à couche connu sous le nom de modèle OSI de l'ISO, le protocole LonTalk offre des services à chaque couche du modèle (ce qui est assez unique pour un réseau de terrain). |
|
|
|
|
|
Sans entrer dans les détails de chaque couche et service, notons néanmoins ce qui fait l'originalité du protocole :
- Le protocole LonTalk est compatible avec tous les supports physiques de communication.
- Chaque équipement peut initier un échange d'information indépendamment de tout maître, arbitre ou superviseur. Certains échanges d'informations peuvent être définis comme "prioritaires". Ils seront effectués avant les autres non prioritaires ou de priorité inférieure.
- Le nombre de stations dans un réseau LON™ peut être très important. L'adresse logique d'un équipement est composée d'un champ domaine, un champ sous réseau et d'un champ "nœud". Un réseau peut comporter plusieurs domaines, chaque domaine peut comporter plus de 32000 équipements ou 'nœuds". Les routeurs utilisent les adresses de sous-réseau pour déterminer si un message doit les "traverser" ou non.
- Afin de réduire la charge du réseau, un message peut être envoyé à l'ensemble du réseau, à un sous-réseau ou à un groupe de nœuds (le message est émis une seule fois mais reçu par de nombreux destinataires).
- Chaque équipement est muni par fabrication d'une adresse physique unique. Cette adresse est accessible à travers le réseau en appuyant sur le "bouton de service" normalement présent sur tous les produits LonWorks. Sur les produits interopérables LonMark (voir plus loin), cette adresse physique est aussi indiquée par une étiquette code à barres. L'adresse physique d'un équipement est essentiellement utilisée pour lui attribuer une adresse logique.
- Chaque transmission d'information peut être au choix non-acquittée, non-acquittée répétée, acquittée et même authentifiée. Dans ce dernier cas, le récepteur du message s'assure de l'identité de l'émetteur du message. Ce service, unique dans le monde des bus de terrain, est essentiel dans les applications liées à la sécurité.
- Les services de gestion réseau (installation et maintenance) sont intégrés dans le protocole. On peut, à travers le réseau, installer un "nœud", le tester, lui demander sa liste de variables et même obtenir des statistiques sur les éventuelles erreurs de communication qu'il a rencontrés.
Non seulement, le protocole LonTalk offre un moyen de transmettre des informations entre équipements mais il offre aussi une méthode standard pour exprimer et diffuser l'information, la variable réseau.
|
|
| Le principe d'échange d'informations utilisé par le protocole LonTalk™ repose sur la notion de variable. Une variable représente généralement une information unitaire (une valeur, un état, etc.).
Les capteurs "publient" les informations sur le réseau à travers des variables de sortie. On dit qu'ils "produisent'' la variable. Les actionneurs "s'abonnent'' aux informations dont ils ont besoin à travers des variables d'entrée. On dit qu'ils "consomment'' la variable.
Les relations producteur /consommateur ne sont pas prédéterminées, elles sont définies à l'aide d'un outil de configuration réseau. De même, ces relations ne sont pas immuables, elles peuvent être ajoutées, étendues ou supprimées dès que cela s'avère nécessaire (modification ou extension du site) et ce, sans interrompre le fonctionnement du réseau et donc de l'installation.
Les variables sont typées c'est à dire qu'en fonction du type de l'information, un format standard est appliqué. Ce format international est à la base de l'interopérabilité. Il permet, en effet, d'assurer que des produits d'origines diverses puissent "comprendre" les informations qu'ils s'échangent. Ainsi un capteur de température intelligent d'origine européenne pourra communiquer avec un automate/régulateur fabriqué aux Etats-Unis car tous deux expriment une température de la même manière. Les types de variables standardisés sont appelés des SNVTs (prononcer "snivit").
Exemple des types de variables (SNVTs) communément utilisées en génie climatique :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Type |
Information |
Gamme (résolution) |
Application |
|
SNVT_temp_p
|
Température
|
-273 à 327° Celsius (0,01 °C) |
Température mesurée/de consigne |
|
SNVT_hvac_modeSNVT_hvac_status |
Mode de fonctionnement
|
0 = HVAC_AUTO choix du mode automatique
1 = HVAC_HEAT Chauffage seulement
2 = VAC_MRNG_WRMUP démarrage matinal
3 = HVAC_COOL rafraîchissement seulement
4 = HVAC_NIGHT_PURGE purge de nuit
5 = HVAC_PRE_COOL pré-rafraîchissement
6 = HVAC_OFF Hors fonctionnement
7 = HVAC_TEST Auto-test
8 = HVAC_EMERG_HEAT chauffage d'urgence
9 = HVAC_FAN_ONLY ventilation seulement |
Commande/contrôle du mode de fonctionnement du régulateur de climatisation |
|
|
SNVT_lev_disc
|
Niveau
|
Valeurs discrètes suivantes :
0 = rien / arrêt
1 = bas
2 = moyen
3 = haut
4 = plein |
Niveau de puissance, de vitesse, etc.
|
|
|
SNVT_lev_percent
|
Niveau, pourcentage |
0 à 100 % (0.5%)
|
Humidité relative, % d'ouverture de vanne |
|
|
SNVT_occupancy
|
Présence
|
Valeurs discrètes suivantes :
0 = zone occupée
1 = zone inoccupée
2 = zone temporairement occupée
3 = zone temporairement inoccupée |
Détecteur de présence, Programme horaire
|
|
|
SNVT_switch
|
Commutation
|
Information composite :
Etat : 0 = Arrêt 1= Marche
Valeur : 0-100% (0,5%) |
Vitesse de ventilation E/S logiques |
|
|
SNVT_flow |
Débit |
0 - 65534 litres/sec (1 l/s) |
Débit d'air (VAV), de liquide |
| |
L'architecture
|
|
|
|
|
Tous les systèmes de GTB actuels sont composés de nombreux automates reliés entre eux par des réseaux de communication. Ces derniers permettent :
- à l'exploitant, d'accéder aux divers automates du système pour en vérifier le fonctionnement et transmettre ordres et consignes.
- aux automates, de communiquer et d'échanger des informations utiles et de coordonner leurs fonctionnements.
|
|
|
|
|
| System de GTB traditionnels |
|
|
|
|
|
|
Avant de présenter l'architecture de réseaux LonWorks, il est bon de rappeler les modèles d'architectures utilisés par les systèmes de GTB traditionnels.
La plupart des systèmes de GTB traditionnels utilisent une architecture à plusieurs niveaux comportant divers types de réseaux ou de bus. Dans ce type d'architecture, la majorité des automates sont rattachés à des bus de bas niveau (dit réseau/bus de terrain) qui sont eux-mêmes connectés à un contrôleur de réseau. Ces contrôleurs de réseau sont interconnectés par un réseau de niveau supérieur dit "réseau principal". Les équipements connectés aux réseaux de terrain dépendent du contrôleur maître pour établir la communication entre eux et pour de nombreux autres services (historique, alarmes, etc.). Le dernier niveau est constitué du réseau de supervision qui repose généralement sur un réseau informatique classique. On y retrouve typiquement l'architecture maître/esclave des niveaux inférieurs avec un poste particulier serveur et les autres clients de ce serveur.
Bien que cette architecture permette de limiter le trafic sur chaque réseau de communication, elle présente de nombreux inconvénients parmi lesquels on notera la complexité de mise en œuvre, l'absence de souplesse de configuration et d'extension, le manque d'ouverture et les performances limitées. En effet, la majorité des équipements sont connectés au bus de plus bas niveau qui est généralement le moins performant de tous (c'est généralement le moins rapide, le moins robuste électriquement et celui qui dispose de capacités d'échanges les moins sophistiquées, …)
|
|
|
|
|
| Architecture d'un réseau Lonworks |
|
|
|
|
|
|
Le réseau LonWorks utilise une approche différente basée sur l'expérience acquise dans la mise en œuvre de réseaux informatiques. Ces derniers sont constitués de "segments". Ces segments sont reliés à un réseau fédérateur appelé généralement "arête dorsale" ou à un autre segment au moyen de routeurs intelligents. Le routeur ne se comporte pas comme un maître ou superviseur des équipements rattachés à son segment, il se contente de transmettre les informations d'un segment au réseau fédérateur ou du réseau fédérateur au segment. Il est intelligent en ce qu'il ne laisse passer que les informations qui ont effectivement besoin d'être transférées dans le/hors du segment. Le trafic local entre équipements d'un même segment y reste donc contenu, ce qui évite de surcharger le réseau fédérateur.
Cette approche permet de minimiser le trafic sur l'arête dorsale et de réaliser la nécessaire séparation des automates sans la complexité des architectures à plusieurs niveaux. De plus, ce type d'architecture ne place aucune restriction sur le type de technologie réseau utilisée par chaque segment. Les segments individuels peuvent utiliser la même technologie que l'arête dorsale ou des segments de natures différentes (radio, paire torsadée, courant porteur, fibre optique, infrarouge…) peuvent être reliés à l'arête dorsale à travers les routeurs.
La base d'un réseau LonWorks est donc le segment. Un segment en paire torsadée de type FTT-10 peut comporter jusqu'à 64 nœuds avant de nécessiter un routeur (ou un répéteur). Dans de petites applications, l'intégralité du système de GTB peut résider sur un seul segment.
|
|
|
|
|
| Extension au dela de 64 noeuds |
|
|
|
|
|
|
| A l'aide de routeurs, on peut connecter de multiples segments jusqu'à la limite théorique de 32385 équipements par domaine.
Dans des installations importantes, on préférera cependant utiliser les routeurs pour constituer une architecture de type arête dorsale dans laquelle les segments individuels sont connectés à un segment fédérateur justement appelé arête dorsale. Cette arête dorsale peut utiliser le même support physique que les segments individuels ou une technologie plus rapide telle que le réseau LonWorks à 1,25 Mégabits/sec sur paire torsadée ou fibre optique ou encore Ethernet.
Les segments individuels connectés via un routeur à l'arête dorsale peuvent toujours être étendus au-delà de 64 équipements par un routeur/répéteur si nécessaire. Notons que la norme d'interopérabilité LonMark interdit d'utiliser plus d'un répéteur par segment. |
|
|
|
|
| Utilisation de la topologie libre |
|
|
|
|
|
|
Au sein d'un segment, la technologie "topologie libre" (FTT) permet de connecter les équipements en bus, étoile, anneau, peigne, etc.
Le FTT est, de ce fait, la technologie la plus utilisée dans le secteur du bâtiment. Il est donc intéressant de rappeler les caractéristiques et avantages de ce support de communication.
Le FTT peut être utilisé avec une grande variété de câbles. Les critères de choix peuvent intégrer le coût, la disponibilité ou les performances attendues. Ces dernières peuvent varier avec le type de câble car la transmission est affectée par la résistance, la capacité mutuelle et la vitesse de propagation.
|
|
|
|
|
| Avantage de la topologie libre comparée au bus traditionnels des systemes GTB |
|
|
|
|
|
| Topologie libre : simplifie l'installation et en réduit les coûts. Présente un énorme avantage pour les extensions futures car elle permet d'ajouter de nouveaux équipements au réseau en les accrochant à n'importe quel endroit du réseau.
Isolation électrique : la plupart des bus de GTB utilisent la liaison RS485 qui n'offre une isolation en mode commun guère supérieure à la dizaine de volts. Les transmetteurs FTT LonWorks sont isolés par transformateur jusqu'à 1500 volts ! Cette isolation élimine les problèmes de différentiel de tension sur l'on rencontre souvent dans des longs réseaux ou des réseaux inter-bâtiments et offre un haut degré de protection contre les parasites électriques.
Absence de polarité : la plupart des bus de GTB sont polarisés (conducteurs plus et moins). Le FTT non polarisé, simplifie donc l'installation et réduit le temps passé à trouver les défauts de câblage.
Communication d'égal à égal : Dans une architecture Lonworks, les automates, capteurs et actionneurs intelligents s'échangent des informations d'égal à égal sans passer par un maître qui gérerait les communications inter-équipements. Ceci permet de définir des stratégies de pilotage locales et globales et de réduire les effets d'une panne d'un équipement.
Protocole Standard et Public : LonTalk est un protocole standard qui facilite l'interopérabilité des équipements de fournisseurs différents.
Indépendant du médium : LonWorks peut interconnecter des supports physiques différents (y compris la radio et le courant porteur) à l'aide de routeurs. Ceci permet de choisir le support physique le mieux adapté aux contraintes d'une application sans affecter les équipements eux-mêmes.
|
|